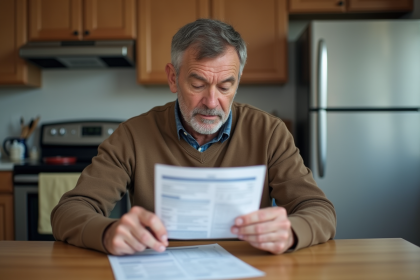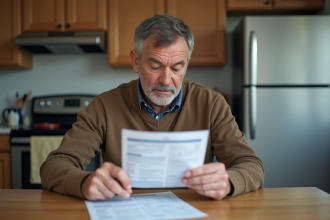Un déséquilibre du pH suffit à laisser proliférer des micro-organismes capables de transformer l’eau d’une piscine en une solution verte en quelques jours seulement. Un traitement de choc inadapté aggrave souvent la situation, rendant les produits classiques inefficaces.
L’accumulation de matières organiques et la filtration insuffisante constituent des facteurs aggravants rarement identifiés à temps. Certains algicides, mal employés, favorisent même la résistance des algues.
L’eau verte dans la piscine : d’où vient ce phénomène si fréquent ?
L’apparition d’une eau de piscine verte ne doit rien au hasard : c’est le signe que des algues se sont installées en nombre. Leur croissance découle presque toujours d’un déséquilibre du bassin. Plusieurs paramètres, souvent négligés, ouvrent la voie à cette invasion silencieuse : pH mal réglé, désinfectant devenu trop discret, filtration paresseuse ou température qui grimpe.
Pour mieux comprendre ces déclencheurs, voici les situations qui ouvrent grand la porte à la prolifération :
- Un pH qui sort de sa zone de confort dérègle le bassin et affaiblit l’efficacité des désinfectants.
- Une filtration sous-dimensionnée ou oubliée laisse les particules s’accumuler et crée un refuge idéal pour les algues.
- Dès que le thermomètre s’affole, la vie biologique s’accélère, et les algues se multiplient.
Mais la teinte verte n’est pas l’apanage des seules algues. D’autres invités inattendus participent à la fête : un excès de cuivre dans l’eau, des poussières de pollen charriées par le vent, les engrais du voisinage ou les restes végétaux, qu’ils soient feuilles, fleurs ou brindilles. Tous ces éléments enrichissent le bassin en nutriments. Résultat : les algues trouvent là un menu complet pour se développer à toute vitesse.
Un point de vigilance mérite une attention particulière : la présence de phosphates. Véritables accélérateurs pour la croissance des algues, ils débarquent dans l’eau via les ruissellements, les engrais agricoles ou domestiques. Si votre piscine côtoie un jardin fleuri ou subit les caprices de la météo, la menace verte rôde plus que jamais.
Chaque coup de vent, chaque averse, apporte son lot de débris organiques et poussières. Ces apports extérieurs nourrissent sans relâche toute la microfaune du bassin. Les produits anti-algues peuvent bien faire illusion un temps, seule une gestion rigoureuse de l’équilibre de l’eau et une attention constante sur les apports extérieurs limitent réellement l’apparition du phénomène.
Comment reconnaître une eau de piscine qui vire au vert (et réagir vite)
Repérer rapidement l’arrivée du vert, c’est limiter les dégâts. Les premiers signes sont rarement trompeurs : l’eau perd en limpidité, prend des reflets douteux, oscille entre émeraude et trouble laiteux. La lumière ne traverse plus comme avant. En passant la main sur une paroi, une sensation grasse et glissante se manifeste : le fameux biofilm algal vient de s’inviter sur les surfaces et le fond du bassin.
Ce ressenti n’est pas anodin. Une odeur organique, parfois marécageuse, commence à flotter. À ce stade, il ne s’agit plus d’un simple souci esthétique. Les bactéries et les algues s’associent, dégradant la qualité de l’eau et la rendant potentiellement nocive pour les baigneurs.
Les risques sanitaires associés à une piscine verte ne se limitent pas aux yeux : irritations de la peau, conjonctivite, otite, voire troubles digestifs ou respiratoires peuvent survenir. Pour éviter d’en arriver là, il faut guetter certains signaux :
- Observez l’aspect de l’eau et touchez régulièrement les parois pour détecter toute anomalie.
- Inspectez la présence d’un film glissant, signe d’un début de prolifération.
- Intervenez dès l’apparition des premiers reflets verts, avant que la situation ne se complique.
Il ne s’agit pas d’une simple question de confort visuel. La santé du bassin dépend de la rapidité d’intervention. Plus vite vous agissez, plus vous limitez la prolifération des micro-organismes et préservez la qualité de la baignade.
Les solutions efficaces pour retrouver une eau claire sans prise de tête
Face à une eau qui vire, une seule règle : enclencher la filtration en continu. Laissez la pompe fonctionner jour et nuit jusqu’à ce que l’eau retrouve sa clarté. La filtration reste la pièce maîtresse de tout le système : elle piège algues, particules et débris. Un check-up s’impose : nettoyage du préfiltre, contrôle du skimmer, vérification du filtre à sable. Ce travail minutieux conditionne le succès du rétablissement.
Ensuite, place au contrôle du pH. Avec un testeur, vérifiez sa valeur puis ajustez-la : un peu de bicarbonate de soude pour remonter, ou un correcteur adapté pour abaisser, jusqu’à atteindre l’équilibre idéal entre 7,0 et 7,6. À ce stade, le chlore ou le brome déploie tout son potentiel désinfectant.
L’étape décisive : le traitement choc. Ajoutez une dose puissante de chlore choc, de brome ou d’oxygène actif, selon la configuration du bassin et la sensibilité des nageurs. Ce traitement cible les membranes des algues et des bactéries, les éliminant efficacement. Plusieurs marques, dont Marina, Ocedis ou HTH, proposent des solutions prêtes à l’emploi pour faciliter la tâche.
Pour accélérer la récupération de la transparence, il est judicieux de recourir à un floculant. Ce produit rassemble les particules les plus fines, facilitant leur élimination par la filtration. Un nettoyage manuel ou l’utilisation d’un robot complète l’opération en s’attaquant au biofilm qui s’est formé sur les parois. Après ce traitement, la baignade peut reprendre dans une eau limpide, où la sécurité n’est pas sacrifiée sur l’autel de la rapidité.
Petites habitudes à adopter pour dire adieu à l’eau verte toute la saison
Garder une eau de piscine irréprochable ne relève pas du miracle, mais d’une série de réflexes simples à inscrire dans la routine. Dès que la baignade s’achève, couvrez la surface avec une bâche de piscine. Cette barrière limite l’arrivée de débris végétaux, feuilles, pollen, brindilles, et ralentit l’évaporation du chlore.
Pour assurer la stabilité de la qualité de l’eau, quelques vérifications régulières s’imposent :
- Testez le pH chaque semaine, et réglez-le pour rester dans la zone idéale (7,0-7,6).
- Gardez un œil sur le taux de désinfectant et ajustez dès le moindre écart.
- Faites tourner la filtration suffisamment longtemps : en règle générale, la moitié de la température de l’eau en heures par jour.
- Entretenez le filtre à sable ou les cartouches pour éviter qu’ils ne se colmatent.
Le nettoyage ne s’arrête pas à l’épuisette : brossez régulièrement les parois, aspirez le fond, et insistez sur les recoins où le biofilm algal s’accroche. Les nageurs eux-mêmes apportent leur lot de pollution organique : une douche rapide avant la baignade réduit nettement l’introduction de phosphates, ces alliés des algues.
Par anticipation, un traitement anti-algues s’avère judicieux dès que la température monte ou si le bassin reçoit davantage de baigneurs. Adopter ces gestes, c’est s’assurer une eau limpide, sans subir les caprices d’un bassin qui tournerait au vert.
Une piscine éclatante tout l’été, ce n’est pas une promesse marketing : c’est la preuve qu’un entretien régulier en dit bien plus long que tous les traitements miracles.